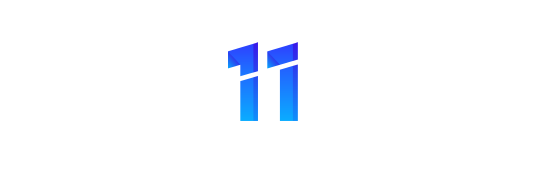Un an après l’accession au pouvoir du Président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko, l’heure est au bilan. Élue sur un discours de rupture, l’administration actuelle fait face à de nombreux défis institutionnels, économiques et sociaux. A-t-elle amorcé une véritable transformation du pays ou s’est-elle adaptée aux contraintes du pouvoir ? Est-elle responsable des difficultés économiques actuelles ou subit-elle l’héritage du régime précédent ? Le gouvernement doit-il revoir sa stratégie pour répondre aux attentes des citoyens ? Autant de questions cruciales qui dessinent les contours des années à venir.
Une rupture annoncée, mais des adaptations imposées
La promesse de rupture était au cœur du projet politique du tandem Diomaye-Sonko. Dès son élection, le nouveau pouvoir a affiché une volonté de réforme en profondeur des institutions, avec un engagement pour la transparence, la refonte de la justice et la souveraineté économique. Des initiatives comme la lutte contre la corruption et la révision constitutionnelle sont venues renforcer cette image de changement.
Cependant, la réalité du pouvoir s’est avérée plus complexe. La loi d’amnistie adoptée pour solder les contentieux politico-judiciaires a suscité des critiques, perçue par certains comme une entorse au principe de reddition des comptes. Sur le plan politique, la gestion de l’Assemblée nationale a révélé des tensions internes, et les relations avec des institutions comme la CEDEAO ou certains partenaires occidentaux ont parfois été marquées par des crispations.
Si la rupture est visible dans le discours et certaines décisions, l’adaptation aux contraintes du pouvoir semble inévitable. Gouverner impose des compromis et la nécessité de naviguer entre aspirations populaires et exigences institutionnelles.
Crise économique: responsabilité du gouvernement ou héritage du passé ?
L’un des principaux défis du gouvernement reste la situation économique. Le Sénégal fait face à une inflation persistante, à des tensions budgétaires et à un climat des affaires incertain qui inquiète les investisseurs.
D’un côté, le pouvoir met en avant la mauvaise gestion passée, soulignant l’endettement élevé du pays et la dépendance excessive aux importations. Le gouvernement a aussi entrepris des réformes visant à renforcer la production locale et à mieux gérer les ressources naturelles.
De l’autre, certains observateurs estiment que la communication économique du gouvernement a parfois aggravé la situation, notamment, avec des prises de position qui ont pu inquiéter les partenaires économiques. La fuite de certains capitaux et le ralentissement des investissements étrangers en sont des conséquences directes.
Ainsi, si l’administration actuelle n’est pas directement responsable de la crise, elle doit rapidement mettre en place des mécanismes concrets pour rassurer les acteurs économiques et stabiliser la situation.
Des réformes sociales trop lentes à se concrétiser ?
Sur le plan social, les attentes étaient immenses, notamment, en matière d’éducation, de santé et d’emploi des jeunes. Certaines mesures ont été prises, comme une légère augmentation des salaires dans certains secteurs et la volonté d’améliorer l’accès aux services publics.
Cependant, les réformes tardent à produire des effets visibles. Les enseignants et les travailleurs de la santé continuent de manifester pour de meilleures conditions. Le chômage des jeunes reste un problème majeur, avec peu de solutions concrètes mises en place à ce jour.
Ce retard dans la mise en œuvre des réformes s’explique par plusieurs facteurs : le temps nécessaire pour structurer les changements, les contraintes budgétaires et les résistances internes. Toutefois, l’impatience sociale grandit, et le gouvernement devra accélérer son action sous peine de voir son soutien populaire s’éroder.
Une communication gouvernementale à revoir ?
L’un des points faibles du pouvoir reste sa communication. Si la transparence et la proximité avec le peuple étaient des promesses fortes, la gestion des crises et la stratégie médiatique ont souvent été maladroites.
L’affaire des 40 milliards de la BCEAO a illustré ce déficit de communication : un manque de clarté qui a laissé place à des rumeurs et une perte de confiance. De même, certaines prises de parole de ministres ou responsables ont parfois manqué de retenue, créant des tensions inutiles avec des partenaires internationaux.
Pour préserver son autorité et sa crédibilité, le gouvernement doit structurer sa communication : centraliser les messages, éviter les déclarations intempestives et adopter un ton plus institutionnel. Une meilleure pédagogie des réformes permettrait aussi d’expliquer les décisions et de rassurer la population.
Le grand test : transformer les promesses en résultats
Le plus grand défi du tandem Diomaye-Sonko sera désormais de concrétiser ses engagements avant la fin du quinquennat. La patience des citoyens n’est pas infinie, et les attentes restent élevées.
Pour réussir leur mission, les tenants du pouvoir doivent, donc, trouver des solutions urgentes, opportunistes et efficaces. Il devra stabiliser l’économie en rassurant les investisseurs et en accélérant les projets de souveraineté économique, accélérer les réformes sociales pour répondre aux urgences en matière d’éducation, de santé et d’emploi et renforcer la gouvernance institutionnelle en trouvant un équilibre entre rupture et pragmatisme.
Aussi, le pouvoir actuel doit impérativement revoir sa communication pour éviter les erreurs qui fragilisent son image.
L’année à venir sera déterminante. Un virage stratégique s’impose pour que la promesse de rupture se traduise en progrès tangibles. Sinon, le risque est grand de voir l’espoir initial se transformer en désillusion.
BBF